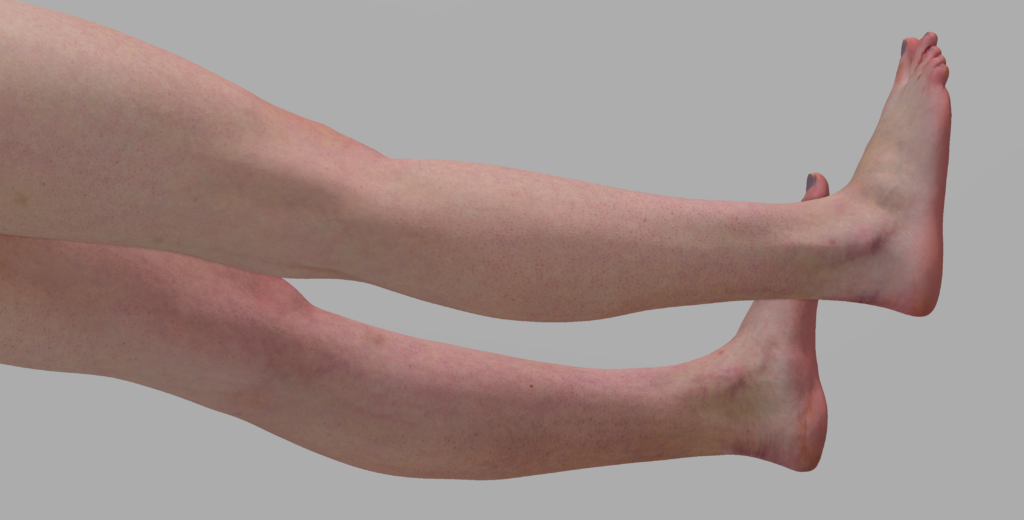TAMBORA, PYRAMUS, FRANKENSTEIN – 2e halte
LONDRES Les couchants rouges d’une année sans été Tomber amoureuse d’un volcan, ça peut arriver.D’un volcan en particulier,ou même des volcans en général.Ça peut arriver à tout le monde, sans doute,et c’est d’ailleurs ce qui arrive un peu à tout le monde dans l’Europe de 1800.Dans l’Europe non volcanique, pour être précise, parce queon tombe quand même plus facilement amoureuse des volcans si on ne vit pas juste en-dessous.En Angleterre, en France ou en Suisse, par exemple,plutôt qu’en Islande ou en Italie. L’Europe non volcanique vers 1800s’éprend donc des volcans. Ils sont partout. Ils sont dans des romans, comme Corinne ou l’Italie,de Germaine de Staël, ouvrage «cosmopolite et féministe» selon le site de la Bibliothèque nationale de France.Ils sont dans des parcs d’attractions, où on simule des éruptionsavec des dispositifs pyrotechniques sur des plans d’eau. Et ils sont dans la peinture. C’est ainsi que à Londres, en 1817, le peintre William Turner peint le Vésuve, qui est particulièrement à la mode. Il le peint en éruption, imaginant le jour où le volcan avait submergé de magma la ville romaine de Pompéi.Turner peint, à vrai dire, toutes sortes de choses:histoires bibliques, scènes mythologiques, incendies, batailles, naufrages en mer, carnavals de Venise, étals de poissonnières,peu importe.L’essentiel, pour lui, c’est le ciel.Ciels troubles, empoussiérés d’orange et de rouge, baignés d’astres mourants, de soleils qui se couchent comme si c’était leur dernière nuit.Ces éclairages évoquant une fin du monde qui s’éternise, c’est sa spécialité. On dit d‘ailleursencore aujourd’hui face à un couchant rougeoyant et voilé, on dit «Oh, regarde, un ciel à la Turner…»Turner peint donc des sunsets à tout va, et en fait il ne le sait pas, mais il peint, en vrai, des aérosols. Euh, si je dis «aérosols», vous pensez quoi?Vous pensez sans doute, je parie, comme moi,immédiatement, spray, bombe, pschitt. Mais lorsque la science dit «aérosols», elle pense à autre chose.Elle pense aux particules fines en suspension dans un gaz qui les transporte et qui les met en circulation. Parmi ces particules aéroportées, on trouve de tout – pollens, spores de champignons, microalgues et bactéries, poussières et suies –et parfois au milieu de tout ça, des sulfates, comme on dit, produits par les volcans en éruption. C’est ainsi que, pendant 30 ou 40 mois, l’éruption du Tambora, dont je vous parlais il y a quelques arbres de cela, éruption dite «méga-colossale» dans le jargon des volcanologues, fait apparaître partout, des aérosols sulfatés qui font plusieurs fois le tour de la planètedans la stratosphère, à quelques dizaines de kilomètres d’altitude, et qui troublent le ciel, donnant au couchant cette beauté maladive qui frappe Turner.Turner qui peint sans faire le lien parce que de tout ça, comme ses contemporaines et ses contemporains, il ne sait rien. Selon une étude réalisée en 2007 par une équipe d’universitaires grec-que-s en comparant cinq siècles d’éruptions volcaniques et d’histoire de l’art, des dizaines de peintresont peint dans les ciels de leurs tableaux les effets d’éruptions lointainessans le savoir.Ces choses se sauront, ces liens se feront, en effet,beaucoup plus tardet je vous en parlerai,mais j’aimerais souligner pour l’instant, juste comme ça,parce que c’est romanesque, un autre lien qui est en fait une coïncidence. À l’époque où l’Occident est en train de vivre une histoire d’amour romantique, artistique et culturelle,avec les volcans, à ce moment-là précisémentse produit, à l’insu de tout le monde ou presquela pire éruption volcanique de l’histoire humaine, une éruption dans laquelle le monde entier se trouve bientôt immergé, car les aérosols produits par le Tambora changeront non seulement les couleurs du couchant, mais aussi la lumière du monde, la température du ciel, la fréquence des pluies, comme on le constatera surtout, sans comprendre pourquoi, un an après l’éruption, en 1816, l’«Année sans été», dans laquelle je vous plongerai quelques arbres plus loin. LA SUITE DU PARCOURS RETOUR à la page d’accueil du parcours-récit Tambora, Pyramus, Frankenstein