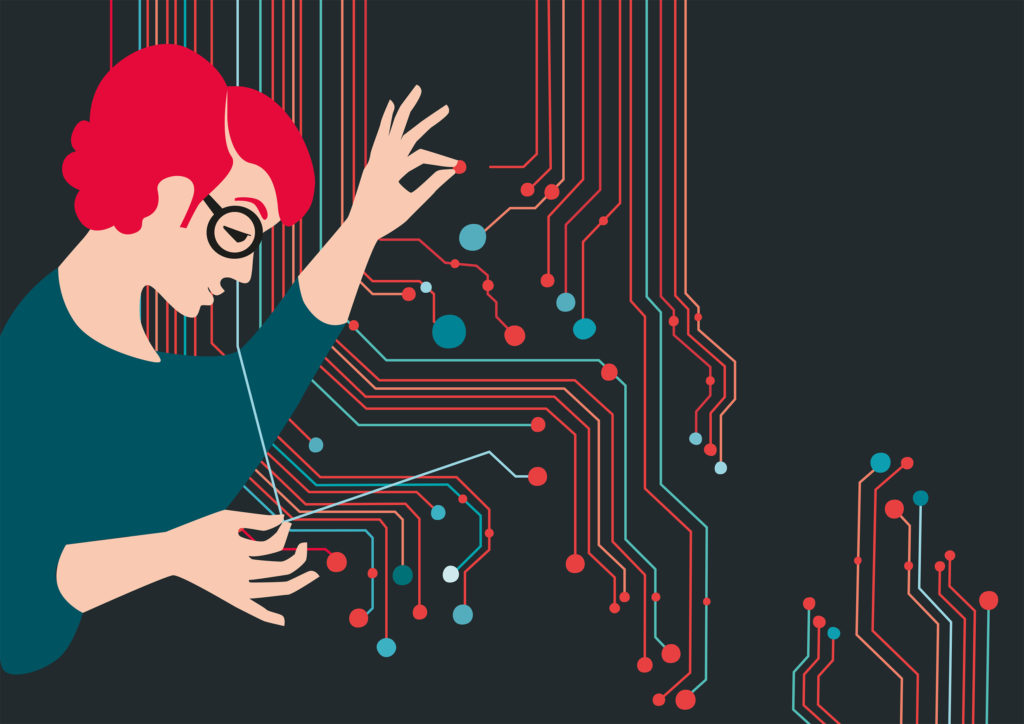Une plongée dans l’imaginaire romanesque et dans les sous-bois historiques du parc des Bastions… Je m’excuse de le dire comme ça, de but en blanc, mais les Bastions, dans les romans, ça sent le sexe. Dans la plupart des fictions qui mentionnent ce parc, qu’elles soient genevoises, américaines ou finlandaises le fait de le traverser fait quasiment office de préliminaires. Bon. Après cet effet d’annonce, après avoir tiré sur cette grosse ficelle, et avant d’en venir au curriculum érotique des Bastions dans la littérature mondiale nous commencerons toutefois par vous parler d’autre chose. Posons, vite fait, ce que l’on sait de source sûre. Bastions, ce sont d’abord des bastions, c’est-à-dire, dans un système de fortifications – et nous citons ici un dictionnaire quelconque – des «ouvrages faisant partie de l’enceinte défensive, faits d’un gros amas de terre soutenu de murailles». Il y en a deux rangées, l’une intérieure, bâtie à l’époque de la Réforme, c’est-à-dire au 16e siècle, au pied de la vieille ville, l’autre extérieure, bâtie au 17e siècle, vers le côté où se tapit aujourd’hui, depuis des temps immémoriaux, cet envahisseur redoutable, le Starbucks Café. Après, Bastions, c’est une promenade, appelée, justement, Promenade des Bastions, créée en 1727, avec une allée cavalière pour se promener en chevaux. Après, Bastions, c’est un théâtre, appelé, justement, Théâtre des Bastions, ouvert en 1782. Ça n’a l’air de rien, ouvrir un théâtre en 1782, mais c’est énorme, parce que depuis deux siècles et demi, c’est-à-dire depuis la Réforme, en 1536, le théâtre était strictement interdità Genève. Et là, pouf!interdit levé. Sauf que, manque de bol, comme on l’apprend dans le livreLa vie musicale au Grand théâtre de Genève entre 1879 et 1918 de Richard Cole, «Quand les autorités municipales autorisent la construction d’un théâtre dans le parc des Bastions en 1782, la majorité de la population locale n’y a pas accès, car la nouvelle salle est destinée en priorité aux actionnaires qui la financent, et aux troupes étrangères stationnées à Genève à l’époque.» Voilà. Les troupes, ce sont les soldats français, savoyards et bernois rameutés à l’instigation du roi de France Louis XVIe pour mater la révolution qui a eu lieu à Genève l’année d’avant. C’est ainsi que le 2 juillet 1782, l’aristocratie genevoise est remise au pouvoir par tous ces soldats, les révolutionnaires sont banni-e-s et un théâtre est construit à la demande des troupes françaises d’occupation qui, elles, n’ont pas l’interdiction divined’aller aux spectacles. Le théâtre est bâti près de l’entrée du parc, sur la gauche, là où l’on voit aujourd’hui, plus modestement, les tables de ping-pong et les jeux d’échecs. Après, Bastions, c’est un Jardin botanique, créé par le savant Augustin Pyramus de Candolle en 1817, avec une serre qu’on appelle une orangerie, et plus tard des daims dans un enclos.Et on ne le dit pas souvent, en fait on ne le dit presque jamais, mais tout botanique qu’il soit, ce jardin-là sert avant tout à manger, parce qu’on pense alors que la science végétale doit se mettre au service de l’agriculture, et surtout parce que Genève subit une disette en 1816 et 1817, c’est-à-dire pas tout à fait une famine mais presque: les gens n’ont pas assez à manger. Dans les Bastions botaniques d’Augustin Pyramus, ce sont donc des patates qui poussent. Après, la faim passée, on remplume le jardin d’une luxuriante végétation en 1871, on bâtit l’université en 1873,on installe des grilles et des portes monumentales en 1875,on ajoute des aigles en bronze en 1885. Après, on détruit l’orangerie pour poser le monument, le Mur, quoi,inauguré en 1917.Monument créé par un sculpteur français du nom de Paul Landowski, qui se fera remarquer une quinzaine d’années plus tard, en 1931, en créant le Christ géant de Rio de Janeiro.Monument, relevons-le aussi, que l’écrivain tessinois Andrea Fazioli décrit ainsi dans son polar La sparizione («La disparition »), publié en 2010: «Quatre grosses têtes en pierre, encrassées par les oiseaux et ignorées de tous.» Ajoutons encore qu’avant, bien avant, au dessous, bien en dessous, court une vaste nappe phréatique provenant de la région d’Etrembières. Avec tout ça, on peut dire, le décor est posé Mais dans ce décor, que s’y passe-t-il? Ça dépend des époques, évidemment, mais aussi des heures. Dans une brève étude intitulée«Le territoire, la territorialité et la nuit», parue dans la revue Actualités psychiatriquesen 1988, le géographe genevois Claude Raffestin écrit ce qui suit: «Dès la tombée de la nuit et pendant deux heures environ, seule subsiste la fonction de passage du parc, sauf pendant les longues soirées d’été. Malgré un système d’éclairage, de nombreuses zones demeurent dans l’obscurité et le déchiffrement du territoire devient difficile, voire impossible. Le système de limites vécu de jour comme une sécurité est vécu de nuit comme un danger, car il isole des rues avoisinantes. Telle zone avec des bosquets qui, de jour, apparaissait comme un refuge, apparaît de nuit comme une source de dangers potentiels. Les repères, e accent grave, deviennent des repaires, ai, c’est-à-dire des lieux où l’on peut se cacher, des lieux d’où peuvent bondir des agresseurs. En somme, la nuit inverse la lecture du territoire: la paix diurne devient le danger nocturne. Le regard devient un médiateur moins efficace que l’ouïe. Celle-ci se substitue à la vue dans une large mesure. Alors que le paysage sonore est à peine pris en compte de jour, il devient source d’information prépondérante la nuit. Les distances sont appréciées et estimées à partir des bruits. Les passages se font d’îles de lumière en île de lumière. A l’inverse, les îles d’ombre ne sont pas désertes et il s’y déroule une territorialité tout à fait spécifique: celle des homosexuels. Aux distributions aléatoires diurnes se substituent des distributions déterministes nocturnes: « passage » dans les zones de lumière et « relations homosexuelles » dans les zones d’ombre.» Fin de citation. Le parc des Bastions et le parc des Bastions, pourrait-on dire, c’est le jour et la nuit.Même si, depuis lors, cette fonction socio-sexuelle du parc nocturne s’est déplacée vers d’autres espaces verts qu’évoque par exemple un quinquagénaire […]